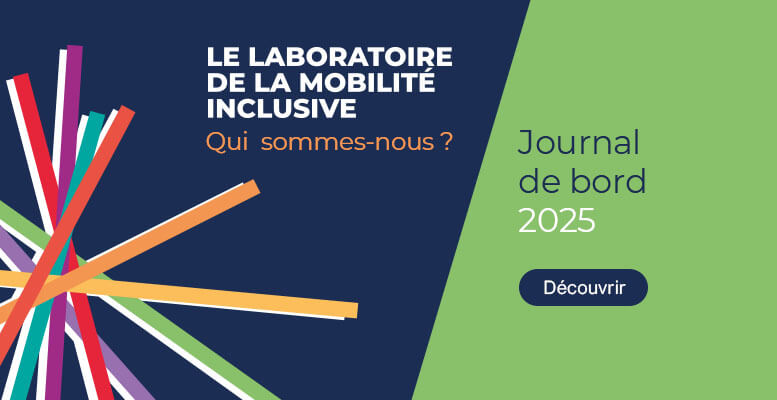[Interview] Frédéric Ville, auteur de « Exode urbain – On vous a menti ! »
![[Interview] Frédéric Ville, auteur de « Exode urbain – On vous a menti ! » [Interview] Frédéric Ville, auteur de « Exode urbain – On vous a menti ! »](https://www.mobiliteinclusive.com/wp-content/uploads/2025/02/Post_WP_ITW_Fr_Ville.jpg)
Dans son ouvrage « Exode urbain – On vous a menti ! », Frédéric Ville, journaliste spécialisé ruralité et aménagement du territoire, décrypte cette tendance qui s’est accélérée avec la crise de la Covid et qui persiste encore, ainsi que les défis qu’elle pose en matière d’aménagement du territoire, de mobilité et de services publics.
LMI. Vous venez de publier Exode urbain – On vous a menti !* ; pourquoi ce livre ?
Frédéric Ville. L’idée d’un exode urbain massif est trompeuse. Mais oui, il y a un mouvement post-COVID vers les territoires ruraux : on parle plutôt d’une renaissance rurale que d’un exode. Les chiffres de l’Insee montrent que les installations en zones rurales, assez significatives pendant la Covid, se poursuivent à un niveau supérieur à ce qu’elles étaient en 2019. Mon objectif était d’analyser ce phénomène et ses implications sur l’aménagement du territoire. J’ai voulu comprendre qui sont ces nouveaux habitants, quelles sont leurs motivations, et si cette tendance peut s’inscrire dans la durée. Le livre démontre que ces mouvements de population répondent à des besoins profonds : une quête de qualité de vie, de calme et de proximité, la recherche de logements plus accessibles. Pour certains, cela devient possible grâce à une réorganisation du travail, avec le développement du télétravail.
LMI. Cet exode est une bonne nouvelle pour les communes rurales, non ?
FV. Oui bien sûr, l’arrivée de néo-ruraux, notamment quand ils font le choix de s’impliquer localement, redynamise les écoles, les commerces et les associations. Mais il faut aussi répondre à des besoins de logement et d’équipements publics. De nombreuses communes ne sont pas préparées à cet afflux : les infrastructures sont parfois vieillissantes, l’offre de logement limitée et de services de proximité, comme les cabinets médicaux, ne sont pas toujours suffisants. Sans vouloir faire la ville à la campagne et sans vouloir réaliser tous les services parfois espérés par les néo-ruraux, il faut néanmoins anticiper cette évolution et permettre aux territoires ruraux d’accueillir ces nouveaux résidents dans de bonnes conditions. Reste à trouver des financements. S’il en existe pour les villes – 42 milliards d’euros pour le Grand Paris Express, 5 milliards d’euros de l’Etat pour Marseille, etc. – ce constat de renaissance rurale doit amener à un rééquilibrage vers les territoires ruraux. « Villages d’avenir » est un bon programme, mais les moyens déployés par l’Etat sont nettement insuffisants.
LMI. En matière d’aménagement, à quels problèmes les villages sont-ils confrontés ?
FV. L’offre de logements est parfois insuffisante, notamment en raison des restrictions du ZAN (Zéro Artificialisation Nette). Si les communes rurales doivent bien sûr aussi freiner l’étalement urbain et peuvent aussi favoriser la rénovation, la densification des dents creuses, tout développement résidentiel et économique harmonieux ne doit pas y être stoppé, quand la demande est là. Il faudrait plus de souplesse dans l’urbanisme et une meilleure articulation entre l’échelon communal et intercommunal pour favoriser une croissance durable. Or, le ZAN a tendance à permettre le développement des villes, mais à figer celui des communes rurales, ce n’est pas accepté par les élus ruraux. En matière de développement économique, le dispositif France ruralités revitalisation (ex-zones de revitalisation rurales) qui permet à des entreprises s’installant dans des zones rurales reculées des exonérations d’impôts et de taxes locales – tout en compensant les recettes pour les collectivités – est une bonne chose, mais il devrait être automatique et non conditionné à la demande de l’entreprise… qui ne le sait pas toujours. Enfin, le manque de transports et de services publics complique l’accueil de nouveaux habitants.
LMI. Comment financer les nouveaux services publics pour les nouveaux arrivants ?
FV. C’est l’un des enjeux majeurs. Les communes rurales disposent de budgets limités et les dispositifs actuels (DSIL, DETR, CPER…) et aides diverses ne suffisent pas. Il faudrait un rééquilibrage territorial avec une meilleure redistribution des ressources nationales. Certains experts, comme Antoine Chéreau d’Intercommunalités de France, plaident par exemple pour un fléchage d’une partie de la contribution climat-énergie pour financer la mobilité dans ces territoires. La question du financement est cruciale : les collectivités rurales doivent investir dans des infrastructures, mais elles n’ont pas les moyens des grandes villes.
LMI. En matière de mobilité, le transport à la demande, le covoiturage… sont-ils des solutions pérennes ?
FV. Il n’y a pas une, mais des solutions. Les transports en commun peuvent être poussés et viables dans des territoires ruraux très dynamiques. Le Clunisois a développé ses rotations de bus par exemple. Mutualiser le transport scolaire avec le transport périscolaire ou en l’élargissant au grand public est pratiqué dans le Cotentin, le Pays d’Issoire, le Puy-de-Dôme… Le transport à la demande et le covoiturage solidaire, qui permettent à des aînés de se déplacer, progressent partout. En la matière, un portage associatif ou mixte association/collectivité, plus volontariste et au plus près des besoins, fonctionne mieux. Le covoiturage organisé entre domicile et travail, avec des applications type Karos ou Klaxit, ou bien des lignes de covoiturage express virtuelles type Ecov, garantissant un temps maximal de prise en charge, conviennent en secteur rural dynamique ou périurbain. En ruralité peu dense, le stop de proximité organisé type Rezo Pouce est adapté. Enfin, le plan ferroviaire de l’Etat n’est malheureusement pas à la hauteur des ambitions en matière de maintien et création de lignes. Toutes ces solutions doivent être intégrées à une réflexion globale sur la mobilité, avec des soutiens financiers accrus.
LMI. En conclusion, quelles seraient les priorités pour ces territoires ?
FV. Il faut plus de souplesse réglementaire et financière pour adapter les infrastructures aux besoins réels des habitants. Il est essentiel de favoriser un aménagement du territoire équilibré, garantissant partout, à la fois attractivité, services publics de proximité et mobilité adaptée. La renaissance rurale est une opportunité, mais elle ne se concrétisera pleinement que si elle est accompagnée d’une politique volontariste et équitable. Enfin, il est essentiel de sensibiliser les acteurs publics et privés sur la nécessité d’un soutien adapté aux réalités des territoires ruraux, sans les cantonner à un modèle inadéquat qui serait calqué sur les villes.
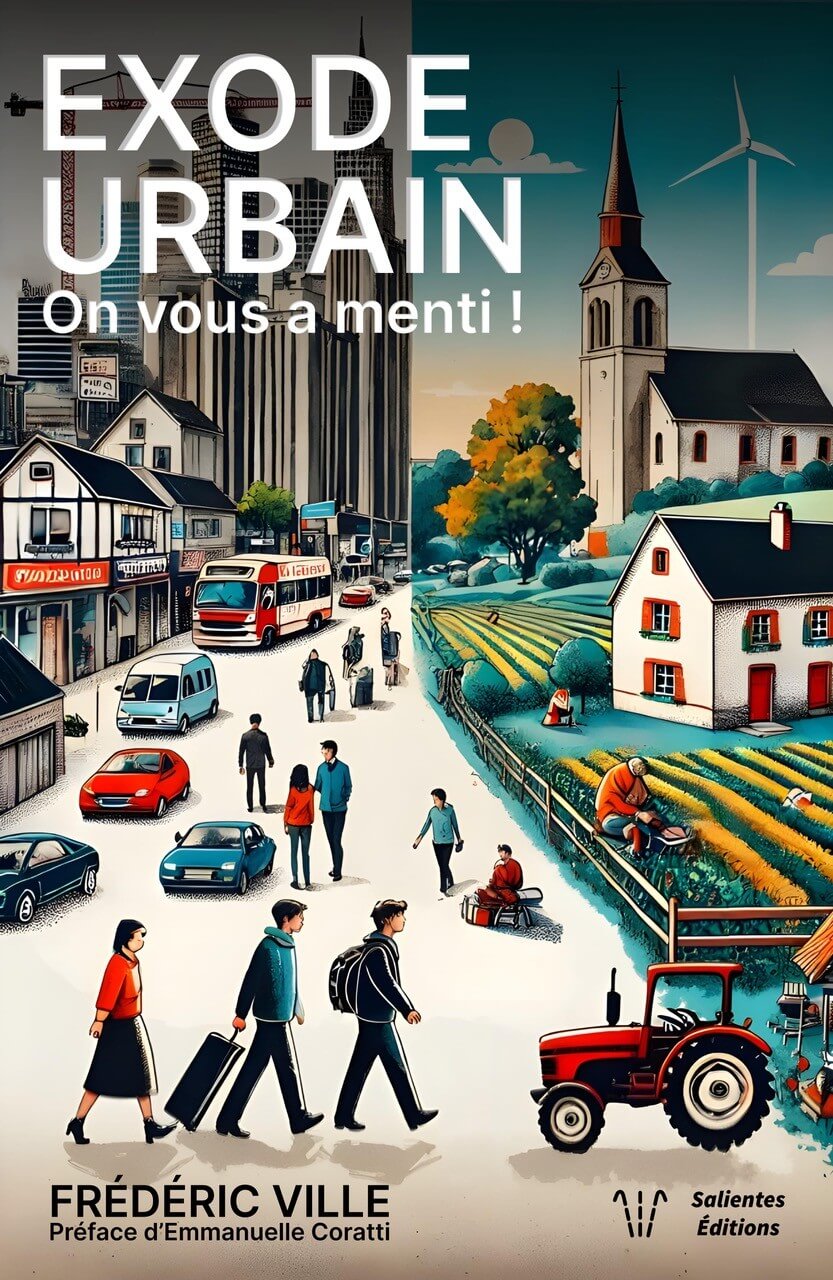
(*) Exode urbain – On vous a menti !
Frédéric Ville
Préface d’Emmanuelle Coratti
Salientes Edition





![[Replay] : Webinaire Tous Mobiles – Episode #17 : « Plan d’Action en faveur de la Mobilité Solidaire, où en est-on ? Chapitre 2 » [Replay] : Webinaire Tous Mobiles – Episode #17 : « Plan d’Action en faveur de la Mobilité Solidaire, où en est-on ? Chapitre 2 »](https://www.mobiliteinclusive.com/wp-content/uploads/2025/01/Vignette-webinaire-2-REPLAY_EP17.jpg)